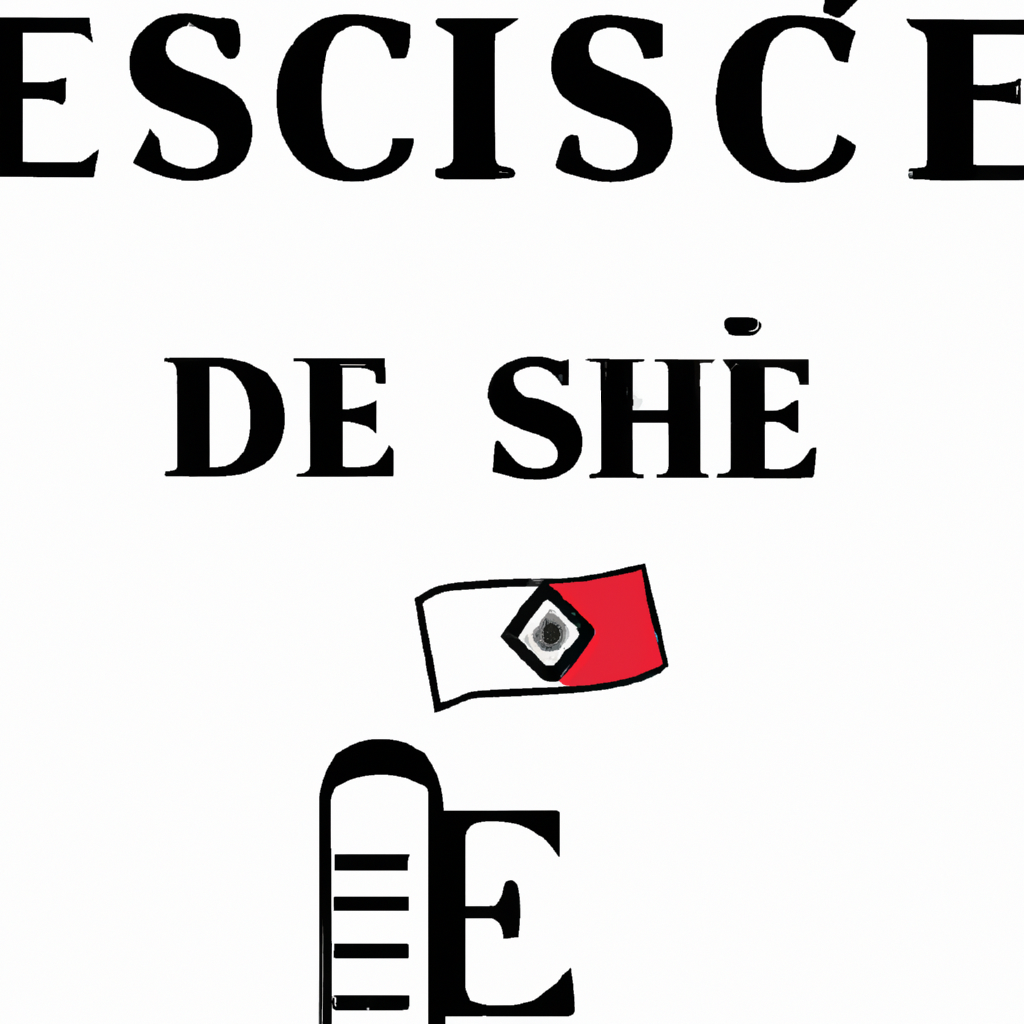Le Conseil Supérieur de l’Éducation a une nouvelle fois rejeté, le 30 janvier 2025, les projets ministériels concernant les groupes de niveau en Sixième et Cinquième. Cette décision, qui fait écho à des précédentes mobilisations contre des mesures jugées discriminatoires, révèle une volonté collective de préserver une éducation égalitaire. Les enseignants, appuyés par des parents d’élèves, continuent de dénoncer un système qui semble davantage favoriser un tri social plutôt qu’une réelle progression pédagogique.
Pourquoi le Conseil Supérieur de l’Éducation a-t-il rejeté les groupes de niveau ?
Le Conseil Supérieur de l’Éducation (CSE) a exprimé un rejet presque unanime des groupes de niveau lors de la réunion du 30 janvier 2025. Ce rejet, qui fait suite à l’annulation précédente par le Conseil d’État des mesures instaurées, révèle une résistance significative face aux choix politiques et pédagogiques du ministère de l’Éducation. Les membres du CSE ont souligné que le modèle proposé par le ministère ne répondait pas aux besoins réels des élèves et semble inadapté à une approche éducative inclusive.
Les enseignant·es, qui sont au contact quotidien des élèves, sont particulièrement inquiets. Selon eux, le principe de regroupement par niveaux contribue à un tri social qui va à l’encontre de l’égalité des chances en éducation. Les témoignages recueillis par les syndicats révèlent que nombre d’élèves ne se sentent pas à leur place dans un système qui met l’accent sur les performances plutôt que sur l’individualisation de l’apprentissage. C’est cette réalité qui pousse le Conseil à insister sur l’importance d’un système qui prône l’intégration.
Quels sont les impacts des groupes de niveau sur les élèves ?
Les mobilisations intersyndicales contre les groupes de niveau illustrent les effets néfastes de cette stratégie éducative sur le bien-être des élèves. Ce système crée une hiérarchie entre les élèves, corrélée à leurs performances, engendrant un climat de compétition malsain plutôt que de coopération et d’entraide. Les jeunes apprenants, au lieu d’évoluer dans un environnement corroborant leur développement naturel, se retrouvent souvent stigmatisés, notamment les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers.
Il est crucial de comprendre quels peuvent être les effets cumulés des regroupements de niveaux sur l’expérience scolaire quotidienne. Ces effets se manifestent souvent par :
- Une augmentation du stress et de l’anxiété chez certains élèves.
- Une rupture du lien avec l’école pour ceux qui se sentent « en dessous » de leurs pairs.
- Des opportunités limitées pour le développement de l’esprit de groupe et de la solidarité.
- Une réduction des interactions entre élèves de différents niveaux, affaiblissant la camaraderie.
Quelles alternatives au système de groupes de niveau ?
De nombreux éducateurs et syndicats prônent une révision profonde du système éducatif actuel. Plutôt que de maintenir des groupes de niveau, plusieurs alternatives peuvent être envisagées. Par exemple, l’implémentation de stratégies d’enseignement différencié, où chaque élève est pris en compte selon ses propres rythmes et styles d’apprentissage, pourrait être bénéfique. Cela permettrait de favoriser la motivation et l’engagement des élèves.
Une autre alternative pourrait être l’intégration de dispositifs comme les ateliers de remédiation, où des groupes hétérogènes d’élèves collaborent sur des projets communs. Cela favorise une dynamique d’apprentissage collectif qui renforce le soutien mutuel. D’autre part, des méthodes d’évaluation continue et formative pourraient mieux correspondre aux besoins des élèves. Ces pratiques permettent d’apprécier les progrès sans stigmatiser ceux qui rencontrent des difficultés.
Quels dangers représentent les regroupements de niveaux pour les enseignants ?
Les enseignants se retrouvent souvent dans une position délicate lorsqu’ils doivent appliquer un modèle éducatif à contre-courant de leurs valeurs pédagogiques. La résistance à l’égard des groupes de niveaux s’exprime également dans leur charge de travail et dans leur engagement professionnel. Beaucoup d’entre eux signalent que cette méthode crée une fatigue professionnelle due à une administration parfois déconnectée des réalités de classe.
Les brassages incessants et les systèmes de pression sur les progressions pédagogiques nuisent à l’atmosphère de travail et au moral des équipes. À cette fin, le travail en équipe et la collaboration entre enseignants sont mis à mal, ce qui peut générer un climat de mécontentement et d’isolement au sein des établissements scolaires. Par ailleurs, ces difficultés peuvent mener à une dévalorisation de la profession, affectant la qualité de l’enseignement.
Comment les parents et la communauté éducative perçoivent-ils ces mesures ?
Les parents d’élèves jouent également un rôle actif dans ce débat concernant les groupes de niveau. Beaucoup d’entre eux expriment leur inquiétude quant à la stigmatisation que subissent leurs enfants. Les mobilisations et les initiatives menées par les associations de parents témoignent de cette volonté de revendiquer des alternatives pédagogiques respectueuses du bien-être et de la diversité des talents des élèves.
Afin de mieux comprendre ces préoccupations, il est pertinent de considérer les avis exprimés :
- Les parents souhaitent un système qui ne segmente pas leurs enfants par performances.
- Ils plaident pour une approche d’apprentissage solidaire, encourageant l’entraide.
- Ils sont de plus en plus actifs dans les conseils d’école afin d’influer sur les décisions pédagogiques.
- La demande d’une communication renforcée entre l’établissement et les familles devient incontournable.

Les récents débats au sein du Conseil Supérieur de l’Éducation révèlent une opposition marquée envers les groupes de niveau en Sixième et Cinquième. Malgré l’annulation de l’arrêté précédent par le Conseil d’État, le ministère persiste à soutenir des mesures qui semblent favoriser une forme de tri social. Cette situation met en exergue une fracture entre les décisions administratives et les réalités vécues par les enseignants et les élèves.
Les mobilisations syndicales témoignent d’une réelle volonté de défendre une éducation plus inclusive et de contenir les effets néfastes que le maintien de ces groupes peut engendrer. Les témoignages des personnels éducatifs illustrent une détresse face à la surcharge de travail et à un climat de travail peu serein. Il est préoccupant que des réformes soient mises en œuvre sans tenir compte des avis des professionnels de l’éducation.
Alors que le ministère cherche à prolonger certains dispositifs, les inquiétudes sur l’avenir de l’éducation nationale persistent. Les enjeux de l’égalité des chances pour tous les élèves demeure un défi que la communauté éducative continue d’affronter. Le rejet des groupes de niveau se présente comme un premier pas vers une transformation nécessaire des pratiques éducatives. L’espoir d’une réforme plus juste alimente les luttes collectives qui s’annoncent encore.